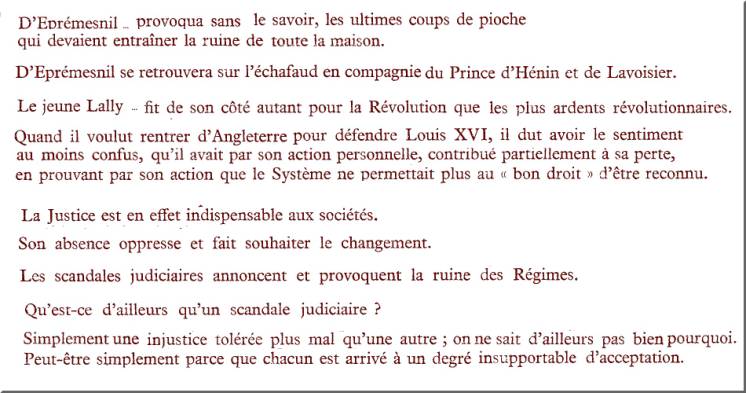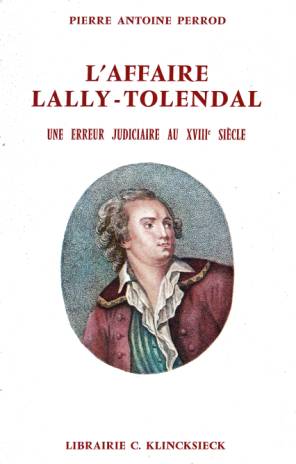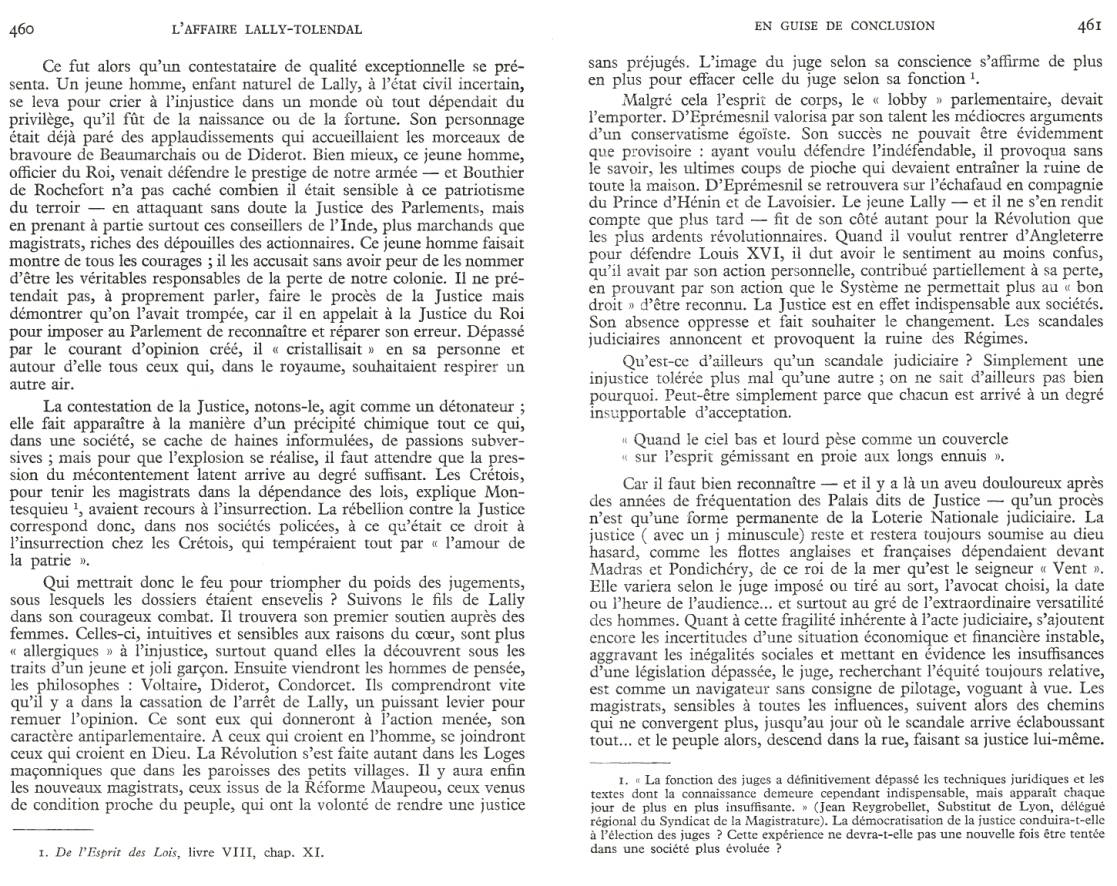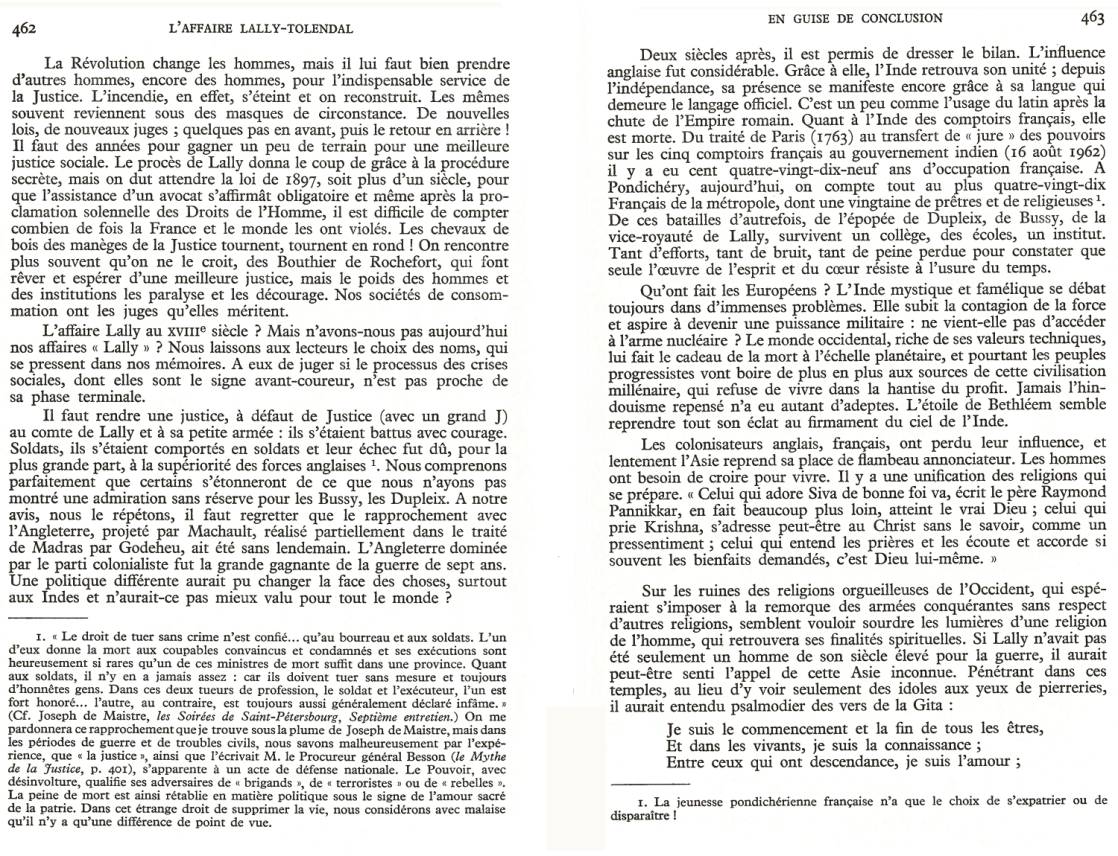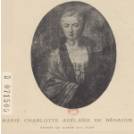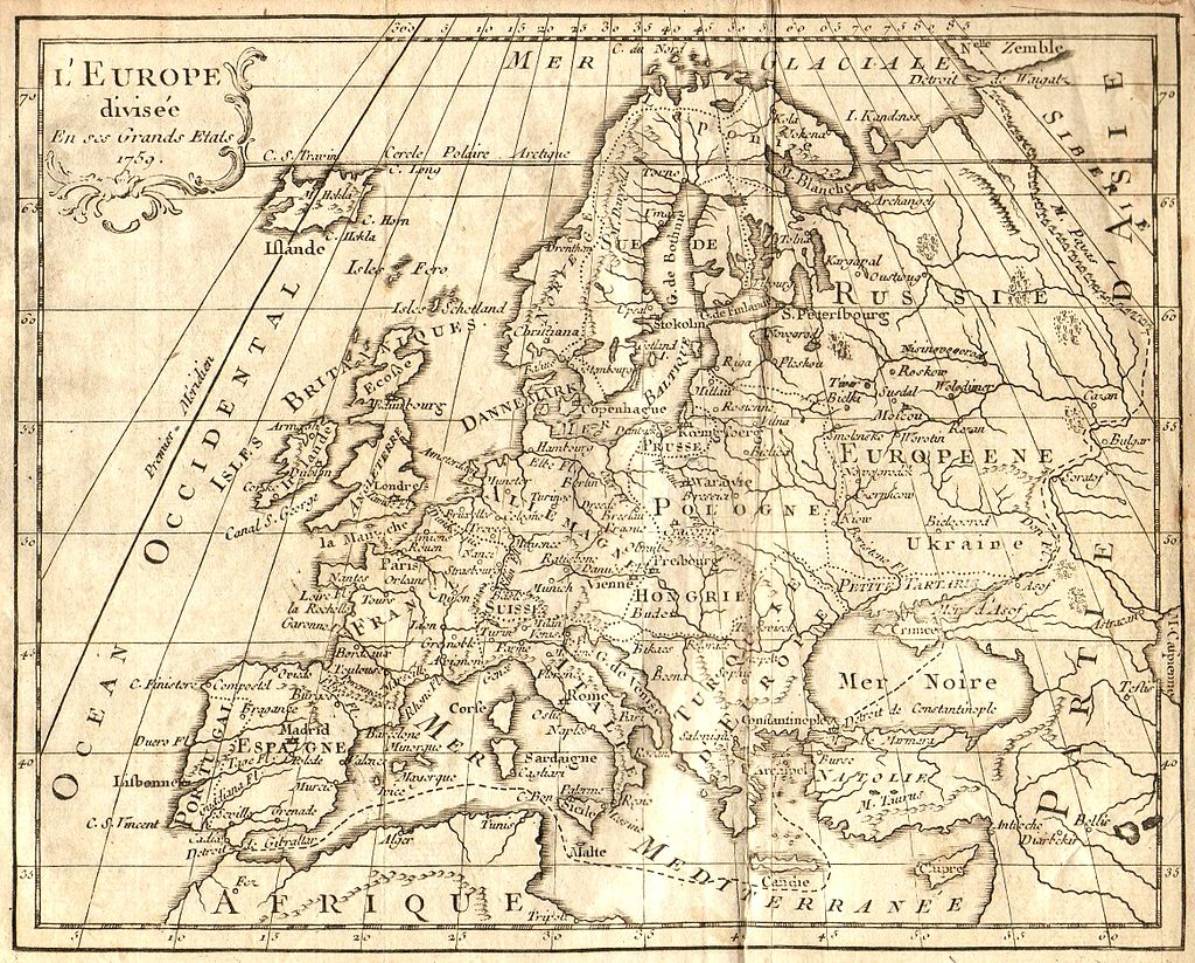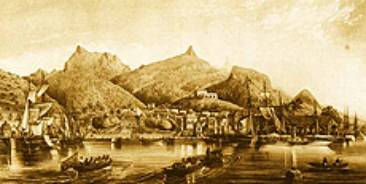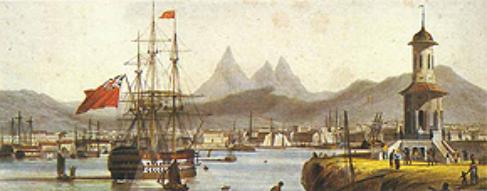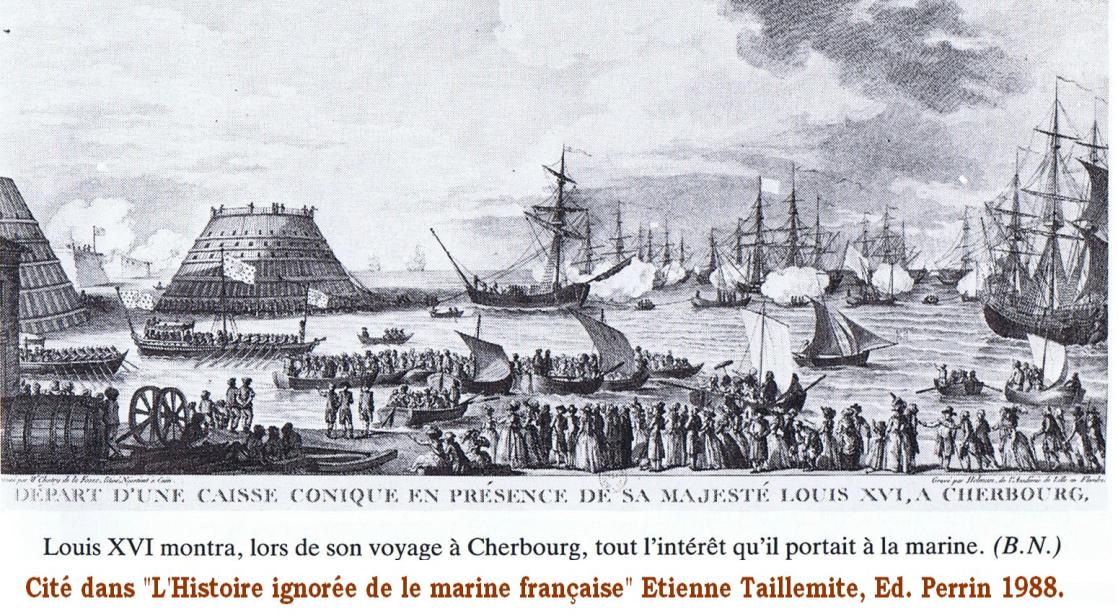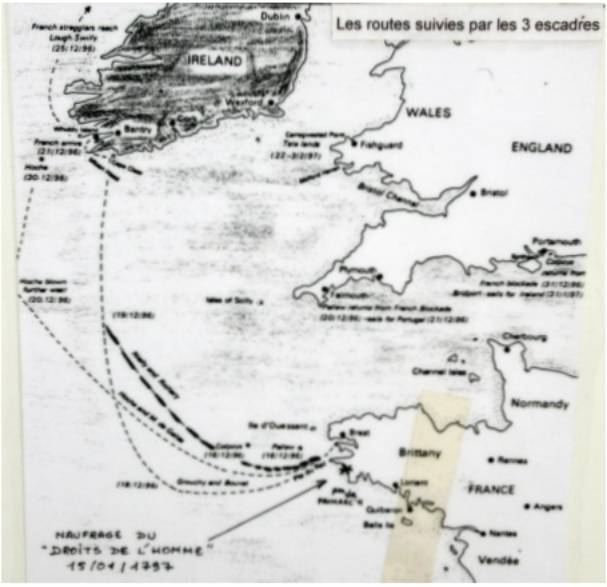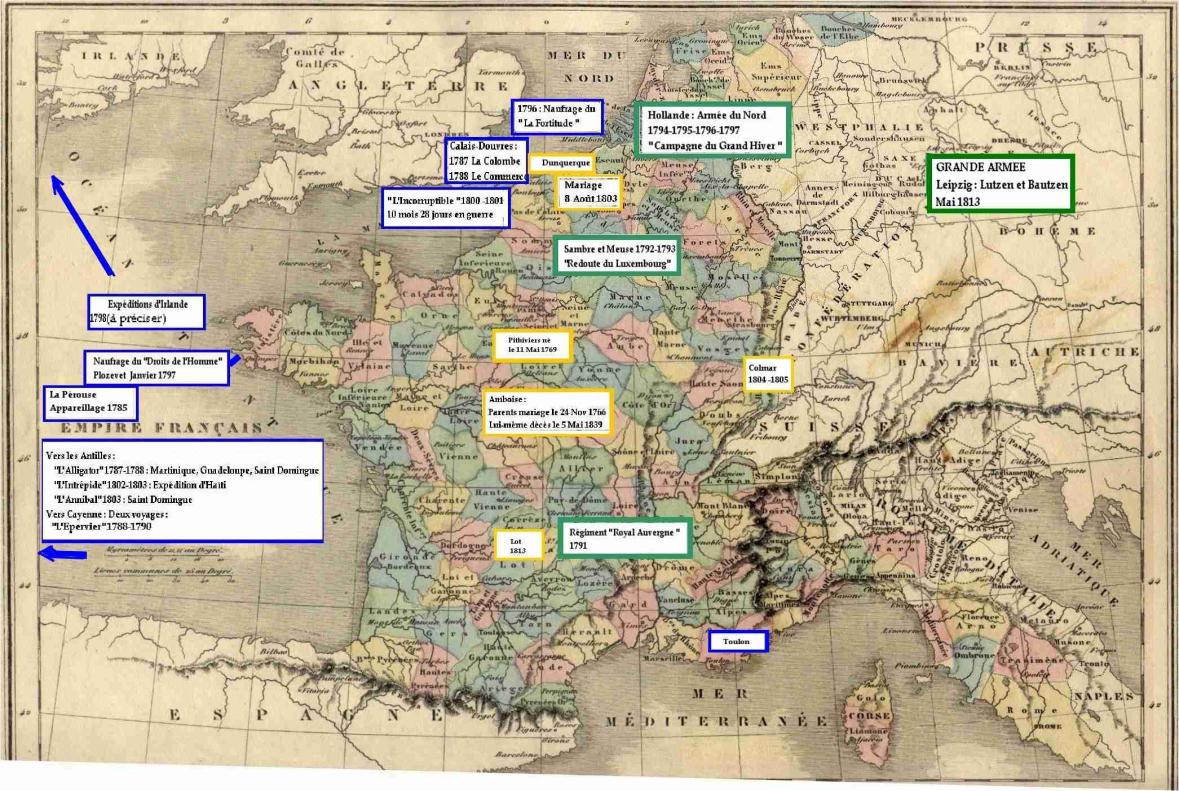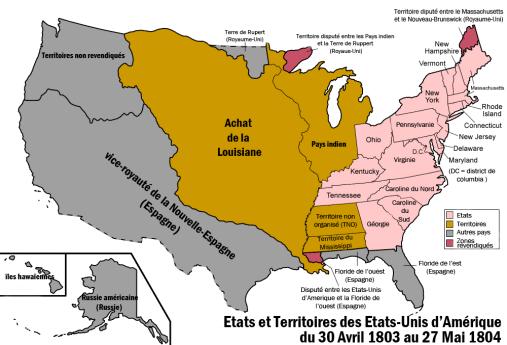|
|
La Marine Française de Louis XV à Napoléon. Enjeu essentiel de la marine et des océans dans les
civilisations, le commerce, les guerres et la politique intérieure. Ø
Calamiteuse politique de
Louis XV => Traité de Paris en 1763 : perte du Canada et des
Indes par la France : 26 années après éclatait la Révolution. Ø
Apogée de la Marine
Française sous Louis XVI => Indépendance des USA. Ø
Révolution
Française => démission du ministre de la Marine La Luzerne en 1791.
Désintégration de notre marine. Ø
Trafalgar le 21 octobre
1805 en est la conséquence directe => L’anglophonie emportera pour longtemps la suprématie mondiale
dans tous les domaines des communications : maritimes, puis aériennes,
puis électroniques [1],
et enfin comme langage de la science. Le « méridien d’origine »
sera déplacé de Paris à Londres (Greenwich). |
||
|
Vaisseau
« Le Protecteur » clic.
|
|
|
|
en cours
d’organisation. Sans prétention à quelque
exhaustivité;
L’intérêt
de la date de 1763 (fin de la guerre de 7 ans, première vraie
guerre « mondiale ») serait de pointer :
-
la date de la plus déterminante des défaites françaises (trop
facilement oubliée)
-
du début du lent effacement de la France face à l'Angleterre,
d’en analyser les causes
-
et celles de la
Révolution de 1789, 26 ans plus tard.
En
particulier mise ici pour Pondichéry en note de bas de page [2].
Il me semble difficile
de penser qu’il n’y ait pas de rapport quasi-direct entre la défaite de la
guerre de 7 ans et la révolution de 1789.
|
ü La
guerre se termine par le sinistre Traité de Paris en 1763, signé après
les désastres de notre marine. Les engagements en effet n’ont pas eu lieu sur
notre territoire métropolitain – (fait constant et remarquable de tous les
temps : Lorsqu’un pays est encore puissant, les combats déterminants
n’ont pas lieu sur son territoire) ü La
perte des armes dans toute la péninsule indienne, l’abandon du Canada
aux Anglais, et autres concessions. ü Le
long procès - ce fut « Le Grand procès » du XVIII ème siècle
- pour trahison des émigrés irlandais catholiques réfugiés en France
et engagés dans la marine de Louis XV, à la suite des persécutions
de Guillaume d'Orange, par fidélité à leur roi catholique
Jacques Ier (réfugié à Saint Germain en Laye) -
Lally Tollendal
fut accusé de trahison qui aurait causé la défaite de
Pondichéry(Vandavachy)(clic) et fut décapité le 3 mai 1766
en Place de Grèves (clic) -
Luc Alen
(sitôt arrivé en France, engagé dans un régiment de marine à 14 ans)
fut emprisonné plus de 2 ans pour les mêmes raisons, puis après plusieurs
terribles procès et fut acquitté mais son avancement ruiné, etc.(clic) -
Pondichéry sera
à nouveau assiégée et détruite en 1778 par les Anglais durant la
guerre d’indépendance des États Unis soutenue par La France. -
Les Canadiens
nous accusèrent alors de trahison, pour les « avoir vendus pour
quelques îles à sucre (Saint Domingue que l'on conserva au traité,
mais seulement jusqu’en 1804 - où la partie française de l'île deviendra
« Haïti » et indépendante) - cependant que Voltaire
assimile ses malheureux habitants français à « quelques arpents
de neige » sans valeur. -
On sait que l’aigreur des Québécois
sera entendue par Charles de Gaule en 1967. -
Les Québécois se battront dans
les cours de justice internationale jusqu’au XXI ème siècle contre
l’illégalité du traité et obtiendront enfin la reconnaissance de leur droit de
facto au passeport français. |
|
|
|
Décapitation
de Lally Tollendal le 3 mai 1766 |
|
Ainsi naquit la révolution … Et parmi les préludes , la justice en question... :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
On sent que ce travail remarquable de P.
A. Perrod (allégé dans ce livre de 470 pages !) est traversé par les
idéaux perdus de Mai 68 en France (dont la réalisation a avorté).
Il n’en reste pas moins que l’analyse
de cette erreur judiciaire est instructive pour tous les temps et en
particulier parce qu’il est révélateur d'un esprit national administratif
qui est peut-être la cause essentielle de notre malheureuse aventure dans cette
guerre de sept ans.
La causalité directe de ces événement
dans la survenue de la Révolution de 1789 y est réaffirmée, mais cette
Révolution est passée, Mai 68 aussi est passé, mais qu’en est-il, quel
est son intérêt encore aujourd’hui ?
A vrai dire il est considérable, bien
qu'il soit douteux – au train où vont les choses - que l’enseignement profite
plus aujourd'hui qu’il ne le fit jadis, hélas !
Notre calamité qui réside en cette adoration
de l’administration qui a également été dénoncée par Alain Peyrefitte
dans « le mal français » daté de la année que l'ouvrage de Perrod,
et il le décèle comme une
permanence dans nos institutions depuis au moins Colbert.
En réalité, l’administration devrait
être un moyen, et nous le prenons en adoration comme une fin.
C’est du fétichisme intellectuel
(psycholâtrie – voir la page « index » de mon site de psychiatrie)
Aujourd’hui, dans les années 2000 la
situation est encore la même, dans une procédure de psycholâtrie
identique, mais avec une idéologie qu’on pourrait dire inverse ( !)
tout aussi grave.
Nous « emphatisons » l’administration
tout en ayant pris le parti de la dénigrer, ou de ne pas la suivre, de lui
désobéir, et la laissons s’écharner sur les peccadilles (ceinture de
sécurité au démarrage … ) mais nous la délaissons et la laissons s’égarer sur
les sujets les plus importants (désorientations temporo-spatiales et
confusions des esprits, pertes de tous les repères, des fidélités et des fois,
immigration sauvage, etc.).
La
question des migrants n’est perçue qu’à propos du quantitatif :
1°
du manque de natalité des Français (dont nous sommes 100% les artisans)
2°
du besoin de main d’œuvre qui en résulte chez nous.
En
réalité du fait de la définition même des mots (les êtres humains
ne sont nullement tous identiques ni équivalents) Le migrant apporte une différence
qualitative.
Et
c’est d'abord à partir de cela qu'il faut le considérer.
Loin
d’attendre une assimilation aussi impossible que sans intérêt – sinon
évidement la possession d'un minimum de compatibilité qui doit être acquis
avant la migration - il faut considérer les diverses différences :
Certaines peuvent être souhaitables, voire hautement désirables
et d'autres au contraire indésirables. Un tri intelligent est qualitatif.
C’est
d’abord ces éléments qu'il faut dans chaque cas estimer intelligemment ...
Ce
qui est évidemment incompatible avec des considération purement numériques
comme c’est devenu généralement le cas, et une administration aveugle.
Finalement, et dans un sens
(authentiquement) psychanalytique, en France , patrie des « droits de
L’homme » (quand tous les autres pays (en Europe, à la différence des pays arabes il est vrai) ont significativement traduit l’expression
par « droits humains » : derechos humanos, human
rights …)
Nous avons inventé « l’homme
standardisé », au détriment de « l’homme original »
et responsable de son particularisme.
Or, l’homme standardisé n’existe pas,
n’a jamais existé et n’existera jamais, par définition (Ce qu'a fort bien
compris Perrod, même dans le
petit extrait cité).
______________________________
|
|
Les
procès de Luc Alen ont été soutenus grâce à l'aide de son épouse Marie Charlotte Adélaïde de Béhague, qui,
après une vie tragique, ayant perdu toute sa fortune dans son aide aux
multiples procès de son époux, accusé de « trahison » comme Lally
Tollendal qui aurait causé la perte
de Pondichéry mais finalement
acquitté à la différence de ce dernier, puis embastillée à Amboise
pendant la Terreur pour cause de « réputée aristocrate dans
l’opinion » devenue veuve et pauvre, donna en mariage sa fille Isabelle
Jeanne Adélaide, à Pierre Louis Person à Calais en 1803. |
On
a l’habitude de parler de la lamentable fin de règne de Louis XV, de la
mise en cause du système, de la réforme des parlements;
Tous
ces points sont parfaitement exacts, mais, derrière eux, est la question de la
mer - aperçue à sa valeur stratégique seulement par les marins et quelques
amiraux ou ministres de la mer - dont le ministre de la marine La Luzerne
qui justifie par écrit sa démission en 1791.
La
véritable cause de tous ces malheurs et destructions sans profit serait donc
une question « de gouvernance » (voir infra)
Cette
question elle-même est connue et selon Peyrefitte (Le mal français
1976) remonterait à Colbert (1619-1683) et même si le mot dérange,
il semble bien durer encore.
Il
me semble qu’on peut facilement le déceler bien plus haut - et je ne vois pas
pourquoi j'en séparerais - en aval - la déjuridiciarisation contraignante voire
stérilisante et parfois meurtrière pour nombre de candidats à la pensée libre,
que l'on a donnée à notre psychiatrie en 1838, dans un statut inénarrable de
féodalité, et dont l’importance n’est jamais soulevée – pas même par Alain
Peyrefitte probablement parce que totalement méconnue (clic) Et c’est pourquoi j’ai écrit et réclamé
un « Habeas corpus » pour le supposé aliéné.
Déjà
en 1513 dans Le Prince (publication posthume en 1531) Machiavel
rend compte des particularités françaises : « Mais si, comme en
médecine - écrit-il en substance - le mal une fois installé est très facile à
voir, il est d’autant plus difficile à guérir »
Je
passe ici sur l’importance vitale, éco-systémique et climatique des océans pour
la Terre)
Après
la trop bien connue et dramatique parenthèse révolutionnaire, la
poursuite des mêmes enjeux reprendra avec Napoléon et une France
affaiblie. Napoléon perdra encore au profit des Anglais, la bataille
de Trafalgar, la possession de l'Isle de France (Ile Maurice)
et vendra aux USA l'immense Louisiane, rive droite du Mississipi,
qui allait du Québec jusqu’à La Nouvelle Orléans au bord du Golfe
du Mexique.
Quelques
décennies plus tard, l’expédition du Mexique de Napoléon III
échouera tragiquement, de même que son projet de royaume arabe, etc.
Et
il ne faut pas oublier que la fondation de l’Université américaine du
Beyrouth (1866) précède l’installation des Français en ces lieux
(arrivée des Jésuites).
Ainsi
les guerres révolutionnaires, puis surtout les napoléoniennes (projet
avorté d'invasion de l'Angleterre) pourraient être considérées comme une
reprise des combats, un peu comme la seconde guerre mondiale (1940-1945)
pourrait être considérée comme une reprise de la première (1914 – 1918)
Dans toutes ces guerres,
les océans, les vents et la marine ont toujours joué un rôle majeur
généralement décisif.
Il
suffit de citer ici les évènements les moins spectaculaires (moins que les
expéditions de Magellan et de Christophe Colomb – qui d'ailleurs résultent
du verrouillage de l'accès occidental aux routes de l’Orient par la Méditerranée
pour les Occidentaux par les Ottomans, jusqu’à la bataille
maritime de Lépante gagnée en 1571 par la chrétienté victorieuse (absence
de la France à cette bataille décisive pour cause d’alliance de la France
avec les Ottomans par François 1er)
Ø
Depuis l’Antiquité aussi loin qu’on la
connaisse :
ü Colonisation
de l’Australie, Tahitiens de Polynésie
ü
Expéditions de la reine Hatchepsout
ü Trafic
commercial et civilisationnel de la période pharaonique : Pharos
(Alexandrie) =>Liban => Grèce (Crête) => Égypte.
ü Colonies
phéniciennes : Fondations de Carthage en Afrique du
Nord, de Malakka (Malaga) ,
de Gadès (Cadix) etc. en 2000 avant J.C. en faisant ainsi les premières
villes européennes)
ü Colonies
grecques : Syracuse, colonies phocéennes de Massilia
(Marseille) Nikè (= La victoire = Nice) puis Anti-polis (= en face de la
Ville (qui était déjà Nice) = Antibes) etc.
ü Guerres
médiques ente la Grèce et la Perse, guerres
Puniques de Rome contre Carthage, Conquête de l’Égypte
par Rome (et apparition du christianisme)
ü Conquète
romaine de l'Angleterre depuis César jusqu’en 80 Ap. J.C.
Ø
Conquêtes modernes : Conquête
normande par Guillaume le conquérant en 1066, puis par les Anglais de la
France
jusqu'aux
plus récentes batailles navales des dernières guerres mondiales, en passant par
les Croisades, l'Expédition d'Egypte de Bonaparte en 1898 et la guerre
hispano–américaine la même année, peu enseignée en France, perdue
par l’Espagne qui perd ainsi Porto Rico et l’île de Cuba
(toujours convoitée par les USA) également en 1898, et enfin l’installation
dans l’île de Cuba des périlleux missiles soviétiques en 1962.
Ø
Enfin toutes les guerres importantes des XIX
eme, XXeme et XXI ème siècles (expéditions d'Iraq, de Libye,
etc.)
-
les
océans
ont toujours joué un rôle majeur dans les stratégies internationales
militaires autant que commerciales
-
les
vents jouent un rôle majeur (Égypte => Liban
=> Crête => Égypte dans l’Antiquité; Moussons ; Trade-winds (vents
du commerce = Alisés); etc... Mais l’importance de la marine a toujours été
sous–estimée par les Français.
-
Et
derrière ces océans, il y a toujours eu des peuples (aux Bahamas en 1492 –
comme en Palestine à toutes les époques)
Il
est certain que la domination du ciel et de l’espace en complète et renforce
l’importance encore mais ne la diminue pas.
Pour
bien des Français, encore aujourd’hui - trop souvent - la mer
c’est : « un charter pour les Maldives » ou « le
mois de vacances sur une plage le dos tourné à la mer » …
|
ROLE DE LA MER EN GENERAL et DANS LES
CONFLITS CONTINENTAUX |
|
||||||||||||
|
Citons
une fois de plus Eric Tabarly : « … Je monte à Paris le moins possible, … comme
dernièrement, quand il a fallu que je me démène pour la sauvegarde du Musée
de la Marine. L'annonce … de l'expulsion du Musée de la Marine de son emplacement
au Palais de Chaillot pour mettre à la place le nouveau Musée des Arts
premiers m'a scandalisé… C'était presque l'arrêt de mort de ce que je crois
être le plus beau musée maritime du monde. Ce traitement révoltant n'est
malheureusement que le reflet de la désinvolture avec laquelle sont traitées,
en France, les questions maritimes. Le peuple français garde une mentalité
trop terrienne… Il reste dans
l'ignorance de l'importance stratégique et économique des océans. Il ne faut
pas lui en vouloir, personne ne le lui enseigne. Cette éducation devrait commencer dès l'école. Mais aucun
manuel scolaire ne souligne que des conflits qui peuvent paraître
continentaux ont été gagnés sur mer. Si
à Trafalgar les Français avaient gagné, il n'y aurait pas eu Waterloo. Si les Alliés n'avaient pas gagné la bataille de l'Atlantique …
les Allemands auraient gagné la guerre… Pourtant, un petit pays comme la Norvège possède une des
premières flottes marchandes du monde. Il en tire de larges profits et prouve qu'il n'est pas nécessaire
d'être asiatique pour faire naviguer des cargos…» J’ajouterais
que si les Français avaient gagné la guerre de 7 ans (qui s’est
déroulée entièrement sur et/ou grâce aux océans), le français tiendrait
aujourd’hui dans le monde la place que tient la langue anglaise, à commencer
par en de grands pays comme l’Inde et le Canada, et en
continuant avec les Etats-Unis sous l’influence de la présence d’un Canada qui
aurait été francophone : Washington a d’abord voulu faire
adopter le français comme langue nationale des Etats Unis, enfantés
par la France, grâce à la marine de Louis XVI qui leur a permis
de se libérer de la tutelle britannique. Et
l’anglais ne fut adopté que par facilité, parce que déjà connu des révoltés. L’Amérique entière (avec par
ailleurs le castillan et le portugais) aurait alors parlé des
langues latines, toutes très proches entre elles. Quelques
remarque sur le rôle historique de la
mer dans les conflits continentaux :
C’est
la mer qui fit gagner les guerres médiques aux Grecs contre les Perses. C’est
Syracuse qui fit perdre à Athènes la guerre du Péloponnèse.
C’est
Syracuse qui fit perdre à Hannibal et aux Carthaginois la
« Seconde Guerre Punique » malgré sa défense par le génie d’Archimède durant 8 mois. C’est
Syracuse qui permit le débarquement américain en Italie à la
fin de la « Seconde Guerre Mondiale ». C’est
par la mer que fut maintes fois attaquée et que chuta Constantinople le
29 Mai 1453, seule ville antique de la Méditerranée à avoir su
traverser le Moyen Age, ce qui marqua la fin de l’Empire byzantin.
Etc. |
|
|
|||||||||||
|
N’oublions pas non
plus que les masses d’eau océaniques, outre la vie de la faune et de la flore
qu’elles contiennent, renferment une énergie gigantesque, propre, et
potentiellement exploitable. Quant au vent, il peut
conférer sans grandes difficultés aux navires, des puissances souvent bien
supérieures à celles des moteurs thermiques ; plus sûres ; gratuites ;
renouvelables et propres. L’exploitation de ces
2 éléments trouve bien sûr des limites – surtout qualitatives – mais fut
certainement un peu trop vite dépréciée, et son importance sous estimée. Mais le seul premier
« vapeur » lancé en mer devait condamner la voile :
Comment manœuvrer un voilier « encalminé » devant un vapeur
lancé à pleine puissance ? Pourtant, dès que le
vent « forcit », les qualités stabilisatrices de la voilure
sont un avantage, tandis que dans une mer « formée »,
tangage et roulis peuvent mettre à mal les moteurs et bien des cargos. Sans vent le moteur a
l’avantage. Quand le vent forcit,
et si la mer est grosse, la voile est plus sûre – alors que les bateaux à
moteurs sont aussi soumis aux vents, mais sans pouvoir en tirer parti. |
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
CONSTRUCTIONS DES NAVIRES FRANCAIS |
|
||||||||||||
|
On lit dans le
livre : « description
des arts et metiers marine » (Fac-similés publiés par la
« Bibliothèque de l’image », 2002, 46 bis passage Jouffroy,
75009 Paris, ISBN 2-914661-56-8) Dans la préface de Laurent Manoeuvre , ingénieur
de recherche à la Direction des Musées de France : « En 1699, Louis
XIV décide de prendre sous sa protection un groupe de savants installé
par Colbert depuis 1666 dans la bibliothèque du roi, rue
Vivienne. Désormais, l'assemblée portera le
titre d'Académie royale des sciences. Elle siégera au Louvre.
Les communications des académiciens seront publiées. Ainsi commencent les
Descriptions des Arts et Métiers. … La flotte française occupe le deuxième rang mondial, derrière celle de la Grande-Bretagne.
Selon les estimations de Pierre
Chaunu, dans les années 1780, mille huit cents navires parcourent
quotidiennement cent vingt à cent trente millions de km2. … On comprend l'enjeu que
représente la publication du texte de Chapman …. Au même moment, sur les conseils
de l'ingénieur Groignard, le ministre de la marine, Sartine,
s'emploie à standardiser les bâtiments militaires … Il ne se contente pas d'amener la
construction navale à un très haut degré de perfection. … S'il propose
des règles de calcul (déterminer le tirant d'eau d'un navire ou son jaugeage)
et les proportions idéales de différents vaisseaux, Chapman ne se
laisse pas aller au vertige de la théorie. L'intérêt de
son texte repose sur un souci constant des choses pratiques : l'arrimage et
la manière de calculer l'espace qu'occuperont les biscuits et les pois
destinés à un équipage de vingt-quatre personnes pendant six mois. En esprit
avisé de l'époque des Lumières, Chapman n'oublie jamais l'homme. La
conclusion de sa préface en témoigne. Il est certes essentiel de se soucier
des détails matériels mais, au bout du compte, c'est l'habileté du capitaine
qui s'avère déterminante.…. Laurent Manœuvre
conclut : « MM. de l'Académie des sciences » ne
s'étaient pas trompés. Cette description des arts de la
marine a sans nul doute contribuée à la réforme voulue par Louis XVI
et par ses ministres, Sartine d'abord, puis le marquis de Castries.
En 1789,
pour la première fois de son histoire, la flotte française (et pas seulement
la flotte militaire) avait en grande partie rattrapé les retards accumulés à
la suite de négligences diverses. Ce
succès était du à la clairvoyance d'esprits éclairés, mais aussi à une
remarquable convergence de vues entre hommes politiques, savants, ingénieurs
et gens d'affaires. Malheureusement, la Révolution et l'Empire
balaieront en très peu de temps les résultats de tant d'efforts. |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
LA MARINE DE LOUIS XV : ON POURRA, D’APRES LES CARTES, JUGER DES
PERTES SIGNEES LORS DU TRAITE DE PARIS DE 1763. |
|
||||||||||||
|
NOTE – Le Traité de Paris de 1763 entre Louis
XV et l’Angleterre : |
|
|
|||||||||||
|
Il serait en fait plus
précis de pointer le « Traité de Paris »
de 1763 qui met fin à la « guerre de 7 ans »
(1756-1763). La France y est contrainte d'abandonner le Canada, la
vallée de l'Ohio, la rive gauche du Mississipi et plusieurs Antilles. Les
Français renoncent à toute prétention politique sur l'Inde où
ils conservent 5 villes démantelées et sans garnison. Ils abandonnent
également leurs comptoirs du Sénégal, sauf l'île de Gorée. La « Guerre
de Sept Ans » est parfois comparé à la Première Guerre Mondiale
du fait de la multiplicité des théâtres d’opérations. Clic pour voir plus grande la
carte. |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
DANS L’OCEAN
INDIEN : L’Inde est perdue. L’île de France ne le sera qu’en 1814. |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
Vandavachy 1760 : Bataille |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
L’île de France => Ile Maurice |
PortLouis |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Le traité de 1763 marque
incontestablement le début du déclin de la puissance française face à
l’Angleterre : Il s’est joué sur mer. Il est à noter qu’au début de la
guerre de 7 ans, l’Inde n’est pas colonisée, ni par la France,
ni par l’Angleterre. Rien n’est joué. Les comptoirs français sont d’une
valeur considérable, en particulier à Pondichery. Brefs les jeux
(entre la France et l’Angleterre) ne sont pas faits. La bataille de Vandavachy
sera déterminante. Une fois encore, un destin
historique du monde va se jouer sur mer : Les combats mettront en jeu la flotte française (Amiral
d’Aché) qui trouve en particulier un solide appui à Port Louis, sur
l’île de France où il arrive en 1757, et pour les troupes terrestres, le
contingent de Lally-Tollendal et ses hommes. C’est un réfugié
catholique irlandais, qui comme beaucoup d’entre eux, et en particulier toute
sa compagnie, fuyant les protestants est venu se réfugier en France.
Il s’engagea sous les ordres de Louis XV. Après la défaite, il sera accusé
de s’être mal battu, et décapité en Place de Grèves à Paris, à l’issu
d’un long procès (qui a concerné les plus hautes instances militaires et de
nombreux accusés) et 2 recours en cassation. (Cf. P.A. Perrod : « L’affaire
Lally-Tollendal. Une erreur judiciaire au XVIII eme siècle », Paris,
1976). On peut même dire que, pour la France,
ce fut « L’affaire judiciaire’ du XVIII éme siècle ». La bataille de Vandavachy,
la défaite de Pondichery, c’était déjà comme une répétition de Trafalgar
quoique plus tôt et plus loin. La conclusion du livre de Claude
Markovits (Cf. note de bas de page) s’inscrit dans les deux grandes
lignes, de ce qui a toujours été le mal français. Nous laissons au lecteur le soin
d’en découvrir le lien : 1.
Une vision trop continentale du monde et une trop grande négligence
des choses de la mer. 2.
Un
bureaucratisme abstrait, inefficace et paralysant, sinon destructeur : Alain
Peyrefitte a raison : là « Le mal français »
est déjà décelable au temps de Colbert : « La victoire britannique s'explique peut-être aussi par la
différence de structures, voire de nature, des deux compagnies : L'East India Company est une société privée; reposant sur la libre entreprise et
l'initiative individuelle, elle vit des profits du commerce asiatique et ne
dépend en rien de l'État, sur lequel elle est en mesure d'exercer une grande
influence, ne serait-ce que par l'intermédiaire de ses directeurs siégeant au
Parlement. La Compagnie française des Indes est en revanche une
entreprise d'État
dont les directeurs sont nommés par la couronne; elle reçoit des subsides du
gouvernement et est alimentée par des revenus étrangers au commerce de
l'Inde, comme ceux de la ferme du tabac. La léthargie caractéristique de ses services et de ses
établissements indiens résulterait de ce contrôle bureaucratique. Soumise à la
politique à courte vue de l'État, paralysée dans ses initiatives, la
Compagnie n'avait aucune chance de l'emporter. En quelque sorte, la victoire
britannique serait celle de la libre entreprise sur une économie étatisée.» L’histoire de Luc Alen est
à peu près la même que celle de Lally, à ceci près qu’il n’eut pas la
tête tranchée : Naît en 1722 ; émigre en France en 1735 ;
s’engage sous le drapeau de Louis XV à 14 ans ; fait campagne
avec Lally de 1757 à 1762 ; de retour en France, épouse Marie
Charlotte Adelaïde de Béhague avant d’être jeté en prison où il
restera 27 mois avant d’être acquitté à l’issu d’un dur procès, dans lequel sa
jeune épouse aura employé toutes ses forces et sa fortune afin de rassembler
les preuves de son innocence ; père de 6 filles et un garçon, il meurt à
Amboise en 1787 et deviendra posthumément le beau-père de Pierre
Louis de Person. Cf. « Carnet de Sabretache » clic. Marie Charlotte, veuve Alen, sera emprisonnée
à son tour, mais à Amboise et sous la Terreur, au motif
d’être : « présumée aristocrate dans l’opinion publique »,
autre épisode de notre roman national que l’on ne développera pas ici. |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Combat naval, Grand Port |
Port Louis après
le « traité de Paris » |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Le « traité de Paris »
de 1763 qui met fin à la « guerre de 7 ans »
(1756-1763). La France y est contrainte
d'abandonner le Canada, la vallée de l'Ohio, la rive gauche du Mississipi et
plusieurs Antilles. Les Français renoncent à toute
prétention politique sur l'Inde où ils conservent 5 villes
démantelées et sans garnison. Il s’y joua le sort linguistique
de l’Inde en son entier, qui aurait aussi bien pu devenir francophone
qu’anglophone, ce qu’elle devint. Un peu plus tard, le président Washington
hésita à faire adopter le français, langue du libérateur, comme langue
nationale aux Etats Unis naissants. L’adoption de l’anglais, déjà
parlé dans les 13 Etats, mais langue du colonisateur, apparut alors comme une
solution de facilité. La langue française bénéficiait
d’une importante aura culturelle dans toute l’Amérique du Nord. Notons aussi que les voisins
hispanophones parlaient une langue sœur du français, facile à comprendre pour
un francophone. C’est cette latinité que Napoléon
III avait le projet d’exploiter lors de son intervention au Mexique. En 1763 la France abandonne
également ses comptoirs du Sénégal, à l’exception de l'île de Gorée.
La « guerre de Sept
Ans » est parfois comparée à la Première Guerre mondiale du fait de
la multiplicité des théâtres d’opérations. Les derniers « français
pondichériens » (quelques milliers) acquerront la nationalité
indienne en 1962, en même temps que l’Algérie accédera à son
indépendance par suite des accords d’Evian. Mais la plupart resteront
sur place, contrairement à leurs compatriotes des départements d’Afrique
du Nord.. Depuis 1763, les Canadiens
français reprochaient souvent à la France de les avoir abandonnés et
trahis, en échange de « quelques îles à sucre » (Haïti et
quelques Antilles). Tout récemment, au terme d’un long
et difficile procès, les plus hautes juridictions saisies reconnurent que Louis
XV n’avait nul droit, au regard des constitutions concernées, de livrer
le Canada.à l ‘Angleterre. Depuis, si j’ai bien compris –
ce qui n’est pas sûr - les Canadiens français jouiraient, dès la
naissance, du droit intangible de posséder la double nationalité, française
et canadienne. Ce qui n’est nullement négligeable. On ne peut s’empêcher aussi de
penser qu’un tel précédent ne puisse avoir quelque valeur de jurisprudence en
d’autres contrées. |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
LE REDRESSEMENT DE LA MARINE DE LOUIS
XVI : |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Selon l’expression d’Éric Tabarly, « la dernière grande marine de la France fut celle de
Louis XVI ! ». |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Les cent sept vaisseaux de ligne de la classe « Téméraire »
furent construits par la France, entre 1782 et 1813 ; ils
constituent la première série de navires de ligne construite selon des plans
identiques, leurs éléments étant ainsi interchangeables entre deux navires de
la série La
coque mesure 55,87 mètres de long, et 14,90 mètres de large. Le déplacement
est de 2900 tonnes. La voilure, dont la surface est de 2485 m², est à trois
mâts, gréés carrés. L'équipage nécessaire pour armer ces navires est de 562
officiers et hommes. Son
artillerie occupe deux ponts complets. Le pont inférieur, le plus proche de
la ligne de flottaison, est garni de quatorze canons de 36 livres, sur chaque
bord. Ce type de pièce, longde 3,274 mètres, pèse 3520 kg, auxquels
s'ajoutent les 900 Kg de son affût. Son service nécessite quinze hommes, il
est capable d'expédier un boulet plein de 17,62 kg à 3700 mètres, environ
toutes les huit minutes. |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Cf. sur
La Pérouse (1741-1788) :clic : En 1756, Jean
François de Galaup, comte de La Pérouse a quinze ans lorsqu'il part pour Brest,
où il sera formé à l'école des gardes de la Marine. Sans doute l'aura de Clément
Taffanel de la Jonquière, son oncle, officier de « la
Royale », a-t-elle eu son influence sur la décision prise par le
jeune homme et ses parents. Devenu officier, il est engagé dans les combats
menés en rade de Quiberon contre les Anglais en 1759 lors de la
« guerre de Sept Ans ». ... Au Canada
... Aux Antilles ... En
Océan Indien en tant qu'enseigne de vaisseau. ... Aux Seychelles
et en Inde où il remonte jusqu'à Calcutta et se bat pour sauver le
Comptoir de Mahé assiégé par des troupes locales. ... A Port-Louis,
sur l'Île de France (actuelle Île Maurice), il devient propriétaire
terrien et se fiance à une jeune fille de la bourgeoisie coloniale. En 1776
revient en France ...Promu lieutenant de vaisseau, il retourne
... soutenir les États-Unis naissants. ... La Pérouse se marie
avec Louise Éléonore Bourdou, sa fiancée créole, et est nommé capitaine
de vaisseau en 1785. Très populaire, il bénéficie maintenant de
forts soutiens au gouvernement et à la cour. Le roi Louis XVI lui-même
le connaît. Une expédition très en vue : En 1784, il est
question d'envoyer une nouvelle expédition dans les mers lointaines ... de
trouver ce fameux « passage du Nord-Ouest » qui permettrait
de contourner le continent américain. Le projet est pris en main par Louis
XVI, depuis toujours passionné par la géographie. Plus que par la
serrurerie, contrairement à ce que l'on prétend communément. Louis XVI opte pour « une expédition dominée par la
recherche scientifique et la reconnaissance des mers, terres et
peuples » que l'on trouvera en chemin. ... On envoie même un espion
en Angleterre afin qu'il rapporte les meilleures informations concernant les
voyages de Cook. ... En font partie des experts
en géographie, géométrie, astronomie, mécanique, physique, chimie,
anatomie, zoologie, botanique, minéralogie, météorologie, mathématiques,
horlogerie… On se dispute les places.
Il a d'ailleurs été dit qu'un jeune élève officier nommé Napoléon
Bonaparte était très tenté par l'aventure. .... « Le
Portefaix » devient « la Boussole » et « l'Autruche »,
« l'Astrolabe ». La première est commandée par La
Pérouse, la seconde par le Breton Paul-Antoine-Marie Fleuriot de
Langle. ... Le 1er août 1785,
La Boussole et l'Astrolabe quittent enfin Brest. ... Madère,
Ténériffe, Trinité, Sainte-Catherine (au Brésil)… Après un passage
tranquille du cap Horn, la Boussole et l'Astrolabe font escale
pendant trois semaines à Conception au Chili où ils arrivent le 24
février 1786. C'est ensuite l'île de Pâques, puis Owhyhii
(Hawaii). Là, se pose la question de
savoir si l'on doit prendre possession de cette terre au nom du roi de France.
La Pérouse s'y refuse, considérant que « l'île appartient à
ses habitants ». |
|
||||||||||||
|
Voyage de La Pérouse |
|
|
|||||||||||
|
L'Alaska et le Canada
occidental sont les premiers
« gros morceaux » auxquels s'attelle l'expédition en juillet
1786. ... La Boussole et l'Astrolabe repartent en suivant la côte
jusqu'à Monterey où la colonie espagnole de Californie fait bon
accueil aux Français. On rembarque pour les îles Marianne et Asunsión.
En cours de route, sont rayées de la carte des îles imaginaires telles que Nuestra
Señora de la Gorta. En mars 1787, Lapérouse
atteint la Chine. A Macao, le naturaliste Dufresne est
débarqué avec quantité de documents qu'il rapporte en France. Commence alors
l'exploration des côtes des Philippines, de Canton et de Formose. La
Boussole et l'Astrolabe passent aussi le long de la Corée et du Japon,
contrées absolument fermées aux étrangers. |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Bataille
entre le vaisseau « Les Droits de l'Homme » et les frégates
anglaises « l'Indefatigable » et « l'Amazon »
les 13 et 14 janvier 1797 en baie d'Audierne. Le menhir « Les Doits de
l’homme » a été dressé à la côte à Plozevet pour commémorer
les combats du vaisseau à la fois contre l’ennemi et contre la tempête |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
APRES LA
REVOLUTION Après les
destructions imputables à la Révolution, la France perdait en 1805
le meilleur de ce qui lui restait encore de sa Marine. Après 1810 , il
n’en restait plus rien. Les conséquences en
furent considérables et définitives (coups portés à la place de la « francophonie »
dans le monde etc.). C’est la Marine
de Louis XVI qui avait permit de gagner leur indépendance aux États
Unis. De ce point de vue, le règne de Louis XVI – si critiqué pour son
inconstance - n’avait pas été totalement exempt de sagesse et de modernité,
après la calamiteuse fin du règne de son grand père. Mais Napoléon ne
put que perdre nos meilleurs possessions d’Outre-Mer et rendit
une France plus petite qu’il ne l’avait trouvée. (pertes d’Haïti,
de la Belgique, de la Savoie, Nice, etc .) Or, le déficit en marine
dont nous souffrîmes alors ne fut pas « l’exception », mais
la « règle » d’un mal chronique : Citons Etienne
Taillemite : « L'un des traits les plus permanents de notre histoire est bien
une extrême méconnaissance des Français, à presque toutes les époques, de
l'importance des espaces maritimes et du rôle moteur des océans dans le
développement des civilisations. Depuis le
temps de Philippe Auguste qui, déjà, le déplorait, jusqu'à l'époque la plus
récente, nos compatriotes n'ont jamais prêté une attention suivie aux
problèmes de la mer et les historiens ne font pas exception à cette règle
... ». |
|
||||||||||||
|
Continuons à suivre
Etienne Taillemite, In « L'Histoire
ignorée de la marine française » Ed. Perrin 1988 : « …
De tous les pays disposant de vastes frontières maritimes, la France
est probablement le seul où l'existence même d'une puissance navale sera …
contestée jusque dans son principe … Peu après avoir
quitté ses fonctions en 1791, le dernier véritable ministre de la Marine de
la monarchie, le comte de La Luzerne, adressait au roi un plaidoyer
qui conserve toute son actualité. Évoquant d'abord
le rôle moteur de l'économie maritime et les dangers d'une récession, «
quel homme versé dans les détails de l'administration, écrit-il, ne prédiroit
pas aussitôt, non seulement que plus de 100.000 matelots, ouvriers des ports,
etc., et leurs familles qu'ils soutiennent sont condamnés à mourir de faim,
mais que le même sort est réservé à plusieurs millions de citoyens habitans
de l'intérieur du royaume et qui ne se sont jamais doutés eux-mêmes que notre
navigation fournissoit le seul débouché que pussent avoir les récoltes qu'ils
moissonnoient ou les marchandises qu'ils fabriquoient dans nos manufactures
». Et comme cette
économie maritime ne peut prospérer sans protection, il ajoutait : « Je regarde la France comme condamnée
par sa position géographique et par l'excès même de prospérité qu'elle a
atteint, sous peine d'éprouver les plus grands malheurs, à être une puissance
maritime et il me semble que le raisonnement et l'expérience démontrent
également cette nécessité. » Celle-ci n'en
continua pas moins d'être largement méconnue, particulièrement dans les
décennies suivantes, et l'on peut penser que Napoléon ne serait sans
doute pas mort à Sainte- Hélène s'il avait disposé de la marine de Louis
XVI. Presque cent
ans plus tard, en 1882, le capitaine de vaisseau Gougeard, ancien
ministre de la Marine de l'éphémère « grand ministère » Gambetta,
constatait « Il faut à tout prix intéresser le grand public français aux
choses de la marine, elles ne peuvent que gagner à être enfin connues,
appréciées sous leur véritable jour, envisagées sur leur véritable terrain ...
Cette indifférence du pays est dangereuse et de nature à mettre la
sécurité en péril. » Il en est plus
que jamais ainsi aujourd'hui où les menaces venant de la mer se sont
prodigieusement accrues… » |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
NAPOLEON LA TERRE ET LA MER : |
|
||||||||||||
|
Bonaparte (1769 – 1821) n’aura pas l’heur de devenir
marin : Bonaparte aurait cherché une ou plusieurs fois à embarquer,
mais se serait vu refuser d’embarquer avec La Pérouse en 1784
ou 1785, au prétexte qu’il n’était pas « un savant ».
Dans cette « course à la science » d’alors, l’expédition
d’Égypte de 1798 pourrait alors apparaître comme une compensation. Il est difficile de
retrouver des précisions peu connues, et qui n’ont d’utilité que d’évoquer de
ces hypothèses qui auraient, de fait, pu transformer le destin de la France,
du fait d’une vocation différente ou d’un autre discernement maritime de
celui qui deviendra Empereur de français. On sait en effet que
la politique maritime de Bonaparte ne fut que successions de désastres. Il n’est pas sûr
d’ailleurs qu’il en portât la responsabilité, car la marine française avait
été quasiment « décapitée » au cours de - et par - la
Révolution, en équipages comme en matériels et en amirautés : La manœuvre tactique
de Nelson fut pourtant élémentaire : Arrivant de l’Ouest au
« portant », il tronçonna l’escadre franco-espagnole (qui
cheminait bien alignée Sud => Nord) en 3 segments qu’il bombarda en
enfilade. Comme les bâtiments
de l’époque ne disposaient que de batteries disposées sur les flancs des
navires, nous ne pûmes alors dans un premier temps que riposter en tirant
dans le vide ! Les marins étant
pourtant braves, les combats furent très violents. Le désastre de Trafalgar
(Cadix), le 21 Octobre 1805, dont la France ne se relèvera
jamais ruina à nouveau la francophonie – en dépit, peut-être, plus tard
d’occasions manquées, comme celle de
cette fulgurante proposition « d’union franco-britannique »
de Churchill le 16 Juin 1940, présentée aussitôt à Bordeaux par
de Gaulle au tout nouveau gouvernement Pétain qui la refusa. La défaite de
Trafalgar s’est jouée en réalité 15 ans plus tôt. La France
considère souvent l’Angleterre comme son ennemi héréditaire. La réciproque n’est pourtant
pas vraie : Churchill dira après la guerre de 1940 que « la
politique traditionnelle de l’Angleterre est de considérer comme ennemi
« la puissance montante en Europe » quelle qu’elle soit »,
ce qui est une politique purement pragmatique, adaptée aux circonstances. L’apogée de la Marine
française pourrait avoir été atteinte en 1790. Dès 1791, le comte de
La Luzerne ministre de la Marine devait démissionner. Selon l’expression d’Éric Tabarly, « la dernière grande marine de la France fut celle de
Louis XVI ! ». |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
« Saint-Domingue » représente la partie occidentale de l’ancienne île « d'Hispaniola », entre « Cuba » et « Puerto-Rico ». Elle fut la principale colonie française des « Antilles » de
1627 au 1er Janvier 1804 (et officiellement le 17 Avril 1825). o De 1627 à 1654, les Français se
concentrent sur les îles, « l'île de la Tortue » et « l’île
à vaches ». o Ils créent ensuite les villes sur
la « grande terre » : o en 1654 « Petit Goave »,
o en 1666 « Port de
Paix », o en 1670 « Cap Français »,
future capitale, qui prendra le nom de « Cap Haïtien » en
1804 o et en 1749, « Port au
Prince » qui remplaça « Cap Français » comme
capitale, prenant le nom de « Port Républicain » entre 1791
environ et 1804. o o o Dès 1720, « Saint-Domingue »
est le premier producteur mondial de canne à sucre et au milieu du XVIII
e siècle, l'île exporte à elle seule autant de
sucre que toutes les îles anglaises réunies. Avant la Révolution, les produits coloniaux de « Saint-Domingue »
représentent un tiers des exportations françaises. Elle devient aussi la principale destination des traites
négrières : La Population est de 455.000
hab. en 1788, dont 405.000 esclaves qui seront affranchis en 1793. Après l’agitation de la Révolution, longue et complexe –
Août 1791 - Janvier 1804 - qui fit plusieurs dizaines de milliers de morts,
cette moitié de l’île devint indépendante sous le nom indien « d’Haïti »,
devenant le symbole de la première révolte noire réussie ; encadrée
dans le temps par l’indépendance des « USA » dès 1776,
obtenue grâce à la Marine de Louis XVI, et celle de « Cuba »
en 1898, après la « guerre hispano - états-unienne ». Les conflits de « Saint Domingue » ont
mobilisé : o
les
esclaves insurgés menés par Toussaint Louverture (se rend en Mai 1802,
est arrêté le 7 juin 1802, décède dans le Jura le 7 Avril 1803). o
les
colons « grands » et « petits blancs », o
les troupes révolutionnaires, o
les
éléments fidèles à la monarchie, o
et
les troupes de Napoléon Bonaparte. L’indépendance
« de fait » est acquise le 1er Janvier 1804 officialisée le 17
Avril 1825 par une ordonnance du roi Charles X qui reconnaît l'indépendance « d’Haïti »,
contre une « indemnité d'indépendance ». |
|
||||||||||||
|
|
« Port-de-Paix » est une ville du Nord-Ouest de l’île « d'Haïti »,
en face et au sud de « l’île de La Tortue », dressée en 1666
par les Français, sur un lieu que Christophe Colomb avait dénommé
« Valparaíso » (« Val - Paradis »). Christophe Colomb, véritablement ébloui par ce qu’il découvrait, la beauté des
paysages, qu’il compare au plus beau de ce qu’il connaissait : « l’Andalousie
au mois d’Avril, etc. », la nudité et la beauté des habitants, les
couleurs des poissons comme il n’en avait jamais vues, croyait avoir retrouvé
le « Paradis » décrit dans l’Ancien Testament: La ville exporta ensuite bananes et café. « Port-de-Paix » est actuellement : Chef-lieu de département
et Sous-Préfecture d'un arrondissement qui comprend quatre communes, « Port-de-Paix »,
« l’île de la Tortue », « Bassin-Bleu », et « Chansolme ». |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Ci-dessus, cartes des navigations et faits d’armes de Pierre Louis de
Person. Une carte mythique ne doit pas faire illusion : On comprendra la gravité dramatique de la situation de la France en 1792 si l’on sait qu’alors père et fils doivent se battre ensemble sur le même front contre l'ennemi.
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
La faiblesse de notre
marine empêcha Napoléon de débarquer en Angleterre (wikipedia : clic). Sur le plan de la
stratégie militaire, Hitler rencontrera souvent les mêmes difficultés
que Napoléon. L’histoire quelquefois se
répète, mais toujours, le rôle majeur joué par les océans reste une constante
dans le développement des civilisations. Il serait temps de ne plus
considérer les vents ni les eaux – douces du ciel, ou salées de la mer –
comme les ennemis de l’homme. Météo : Pourquoi
« la météo médiatique » n’indique-t-elle surtout,
« en boucle », que des températures, souvent illusoires, et
de peu d’intérêt, car n’étant que des pics de brefs instants, et seulement
diurnes, au détriment des vents, déterminants, eux, pour les conditions de vie locales, parmi lesquelles aussi les
températures, et désormais la pollution ? Les anglais
parlent davantage du « wind chill » : La « température
ressentie », est en effet fonction du vent. Ils font
d’ailleurs aussi une différence linguistique entre « weather »
et « time », ce que la langue française ne fait pas :
nous en parlerons dans une autre page. En réalité,
« la météo médiatique » devrait nous indiquer chaque
jour : o
les vents en force et en
direction, o
les pics de
température nocturnes, o
la température moyenne,
et particulièrement celle des sols, au lieu de
répéter un nombre incalculable de fois les mêmes chiffres, de peu d’intérêt,
que les « speakers » appellent : « le mercure » ! Comment
oublier que « la France est un don du Mexique » ? Elle doit la
douceur de son climat – et maintenant sa qualité de l’air - à l’Atlantique, à ses eaux et à ses
vents, et, par eux, aux eaux du « Gulf stream », c’est-à-dire
du « courant du golfe », golfe du Mexique. On oubliera
momentanément la question des pressions atmosphériques et de la formation des
vents, dont la plupart des gens du « grand public » ignore
généralement jusqu’à l’existence. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
L’unique
livre qui décrive la Californie avant qu’elle ne devienne « yankee »
est le livre de Charles Henry Dana : « Two years before
the mast », traduit en français sous le titre de « Deux
années sur le gaillard d’avant ». Ecrit vers 1848
par un jeune étudiant en droit qui s’était embarqué pour 2 ans à Boston, son
intérêt est multiple : il décrit la vie des marins, le passage du Cap
Horn, les presidios espagnols convoitises des « yankees »,
sa poésie enfin. Lecture à ne
pas manquer. Dans un contexte long et
complexe (wikipedia
: clic), Napoléon vend la « Louisiane » aux
« Etats Unis » en 1803, c’est à dire « la rive
droite du Mississipi », « la rive gauche » ayant été
perdue avec d’autres territoires, lors du « traité de Paris »
en 1763. Le territoire vendu
dépasse les 2 millions de km². Napoléon perd « Haîti » en 1804,
« l’île de France » (« île Maurice ») en 1814
etc. Ces pertes sont donc dans le droit fil du « traité de
Paris », mais aussi conséquences de la destruction de l’amirauté
durant « la Révolution », comme en témoigna tragiquement la
défaite de Trafalgar (21 Octobre 1805), bataille
bravement perdue par 37 vaisseaux contre 22. |
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Dans l’opus cité
ci-dessus de Michel Taillemite, arrivé à la guerre de 1914, page 404, l’auteur
poursuit : « … Quant
aux causes de ces insuffisances, ce sont toujours celles qui ont été évoquées
dans les chapitres précédents. On peut les ranger
sous trois grandes rubriques: ·
l'absence
de doctrine et donc l'incohérence de la pensée et des méthodes, ·
des
institutions inadaptées aux besoins et une bureaucratie tracassière et
inefficace, ·
enfin la
perpétuelle instabilité des hommes rendant impossible toute politique suivie. … En 1908, dans son étude sur le Grand
État-Major naval, Castex pouvait encore écrire: « La marine nous donne
actuellement l'exemple d'un grand corps sans doctrine assise, sans mot
d'ordre stratégique ou tactique reconnu, sans conception unanime de la guerre »
… Institutions
inadaptées, absence de tête chargée de décider, conseils multiples et sans
pouvoirs réels, bureaucratie asphyxiante. » __________________________ Ces lignes
sont pratiquement les mêmes que celles par lesquelles Alain Peyrefitte
désigne un mal plus général, sous le nom de « Mal français »
(Plon éditeur, 1976), « mal » qu’il fait remonter au moins à
Colbert, arguant des mêmes causes : o une administration omniprésente, o abstraite o et irresponsable, o excluant du « sérail » ceux qui
ont connaissance o de la pratique o et du terrain. Selon Michel Taillemite,
en matière de marine, l’Angleterre aurait de tous temps été mieux armée
à cause des exigences de son insularité [3]:
« Tout gentleman anglais a son avis sur les
choses de la mer » ____________________________ Autrement dit, les mêmes
structures de ce « Mal français » se retrouveraient
similaires dans tous les domaines et depuis longtemps. ________________________________ Il est amusant de se dire
que tant de contraintes prétendent illustrer « l’apologie de la
Liberté ». |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Epilogue : On terminera cette
remarque en citant à nouveau Eric Tabarly : Il
s’agit de l’engagement d’Eric Tabarly auprès du gouvernement de jacques
Chirac pour le maintien du « Musée de la Marine » place du
Trocadéro à Paris. Dans “Mémoires du large », Editions de
Fallois, Paris, 1997,
Tabarly , homme simple mais « gloire
nationale »(1931 – 1998) écrit: « … Je monte à Paris le moins
possible, … comme dernièrement, quand il a fallu que je me démène pour la
sauvegarde du Musée de la Marine. L'annonce par
la commission Friedmann de l'expulsion du Musée de la Marine de
son emplacement au Palais de Chaillot pour mettre à la place le
nouveau Musée des Arts premiers m'a scandalisé. II était prévu
de mettre les collections en caisses, de les entreposer on ne sait où,
pendant plusieurs années, en attendant de les installer dans un lieu
excentré, trop petit et complètement inadapté : le Musée des Arts
africains et océaniens lorsqu'il serait libre. Bref, c'était
presque l'arrêt de mort de ce que je crois être le plus beau musée maritime
du monde. Ce traitement
révoltant n'est malheureusement que le reflet de la désinvolture avec
laquelle sont traitées, en France, les questions maritimes. Le peuple
français garde une mentalité trop terrienne. Il a découvert la mer par le
côté loisir et il se passionne pour les courses océaniques mais, bien que
sentimentalement attaché à la Marine, il reste dans l'ignorance de
l'importance stratégique et économique des océans. Il ne faut pas
lui en vouloir, personne ne le lui enseigne. Cette éducation
devrait commencer dès l'école. Mais aucun
manuel scolaire ne souligne que des conflits qui peuvent paraître
continentaux ont été gagnés sur mer. Si à Trafalgar
les Français avaient gagné, il n'y aurait pas eu Waterloo. Si les Alliés
n'avaient pas gagné la bataille de l'Atlantique, l'URSS n'aurait
pas pu être ravitaillée, les débarquements en France n'auraient pu avoir lieu
et les Allemands auraient gagné la guerre. Nos
gouvernements, qui ne sont que le reflet des gouvernés, ont toujours
sous-estimé l'importance de la mer. La Marine
nationale est, comme
toujours, le parent pauvre des armées et notre Marine marchande, tuée
par des syndicats irresponsables et des gouvernements qui ont laissé faire, a
pratiquement disparu des océans. Pourtant, un
petit pays comme la Norvège possède une des premières flottes marchandes
du monde. Il en tire de larges profits et prouve qu'il n'est pas
nécessaire d'être asiatique pour faire naviguer des cargos. » |
|
||||||||||||
Fin de page
Notes de bas de page :