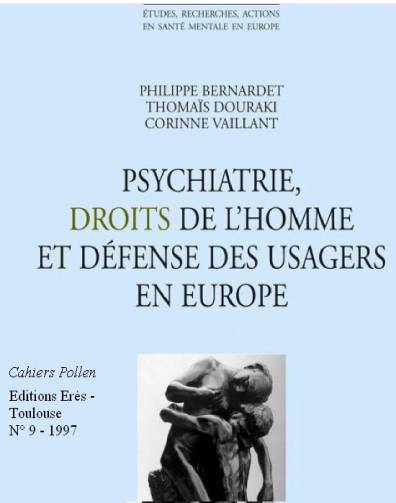|
|
|
par : Docteur jacques de
Person. (Publié dans
revue « pollen » dans le N°9.) Différences entre la « judiciarisation des
hospitalisations sous-contraintes »
et la
« Non-déjudiciarisation des malades mentaux » |
|
Nous réclamons
depuis longtemps la deuxième solution, et rejetons la première. Actuellement
les personnes réputées « malades mentaux » sont « déjudiciarisées »
de deux façons :
• Par l’ancien article 64 du Code
Pénal (devenu le 122-1 du nouveau Code Pénal) en cas de faute.
• Par les anciens “internements”
(appelés depuis la loi de 1990 “Hospitalisations sous contrainte”) s’il n’y
a pas de faute.
Ce sont seulement ces deux lois qu’il conviendrait d’abolir.
La loi du 27 juin 1990,
lorsqu’elle traite des « Hospitalisations sous-contrainte » en
employant le terme même « d’hospitalisation » trace en fait une voie
qui risquera, dans le futur, de concerner tout le champ de la médecine, et non
plus seulement la psychiatrie.
Elle « subordonne » autant
le patient que le médecin à un « tuteur. Actuellement celui-ci est
le Préfet de Police, c’est-à-dire le représentant de l’exécutif.
Remplacer celui-ci par un juge n’abolirait en rien cette « fonction
de tutelle ». Nous retrouvons un peu dans les deux cas, l’antique fonction
« médico-religieuse », des juges et des rois, loin des préoccupations
des Droits de l’Homme, anachronique au sein d’une République laïque et de la
« séparation des fonctions proclamée ».
La « judiciarisation »
des « Hospitalisations sous-contrainte » donnerait aux juges des pouvoirs
d’exception hors de leurs attributions en leur permettant de prononcer la privation
de liberté d’une personne qui n’a commis aucune faute d’une part, et en
confiant au médecin la prise en charge des conséquences de la dépénalisation
de la faute chez une personne « réputée malade mentale ? »
d’autre part. De toutes les façons, elle ne réhabiliterait ni le sujet
hospitalisé dans son statut de sujet, ni le médecin dans sa liberté de
poser des indications thérapeutiques, de les proposer aux patients, de sa
responsabilité du choix des moyens d’accès aux soins et par conséquent des
soins, c’est-à-dire dans ses qualités professionnelles.
Actuellement le fait pour un Préfet
d’ordonner « l’hospitalisation d’office » conduit inéluctablement un
médecin obligé de retenir une personne contre son gré (souvent les deux
« grès », celui du patient et celui du médecin), à prescrire des
médicaments qui jouent dans ce cas le rôle de « camisole de force
pharmacologique ». C’est donc, par l’intermédiaire du médecin,
l’exécution d’une prescription préfectorale. L’usage des médicaments
pose alors question dans ce cas. Qu’un juge prenne la place du Préfet ne
résoudrait pas ce problème.
Si était acquis le principe de la
« judiciarisation des hospitalisations sous-contrainte » — ce
qui s’oppose à la restitution au malade mental de sa personnalité juridique —
le juge serait érigé en tuteur du médecin à la place de l’actuel préfet, mais
le médecin ne serait pas pleinement libre, ni son patient une personne civile
jouissant des principes sacrés reconnus par les déclarations des « Droits
de l’Homme ».
Certes ce serait un changement car
il pourrait permettre d’établir la « matérialité des faits »
et d’instituer un débat contradictoire avec des avocats.
Curieux débat cependant que celui concernant un sujet qui va peut être ou sera déjà dépouillé de sa personnalité juridique (sans qu’aucun jugement de tutelle n’ait par ailleurs été porté).
Ce n’est pas ce que l’on est en
droit d’attendre d’un juge.
Si nous souhaitons que le débat
judiciaire ait lieu, ce n’est pas en tant que débat médical, mais bien en tant
que débat purement judiciaire établissant des faits et éventuellement
des fautes et non pas des solutions médicales — avec ou sans diagnostic
d’ailleurs —.
Certes actuellement, de plus en plus
souvent peut être, les Préfets appuient leurs arrêtés sur des « avis… »,
voire des expertises de médecins. Les juges en feraient autant !. Les
avocats aussi !. On multiplierait les expertises et les contre-expertises.
Certes on aurait peut être une réelle « procédure judiciaire »
(comme nous la souhaitons pour « juger » les actes de la personne)
mais cela ne pourrait en rien constituer un socle de « procédure
thérapeutique ».
Si le juge ordonnait
« l’hospitalisation sous-contrainte », celle-ci placerait le médecin
en position d’exécutant de l’ordre du juge. Même si le juge obéissait à un
expert médecin, elle placerait le médecin hospitalier traitant en exécutant du
médecin expert. Or un médecin expert ne peut être un médecin thérapeute
(traitant).
Non seulement la procédure ne serait
pas un socle pour les soins, un « lit » fait pour le
traitement, mais cela empêcherait tant le médecin thérapeute d’être responsable
de ce qu’il fait que le sujet supposé malade et supposé devenir patient de
formuler une demande de soins.
Ainsi, en définitive, la « judiciarisation des hospitalisations sous-contraintes » n’apporterait pas de grand changement ni pour le médecin, ni pour le patient .
Par contre, n’apporterait-elle pas
un profond changement, peu conforme au principe de la séparation des pouvoirs,
en réunissant entre les mains des juges, qui prendraient la suite des actuels
Préfets, tant les pouvoirs que les documents à la fois de l’exécutif et du
judiciaire ?
Dans le cas des « hospitalisations sous-contrainte à la demande d’un tiers », deuxième forme d’hospitalisation sous-contrainte, qui est d’ailleurs aussi une forme d’ « hospitalisation préfectorale » — on l’oublie trop souvent ! (— puisque les préfets reçoivent les certificats et constituent des dossiers), le médecin thérapeute est aussi obligé, dans la pratique, de prescrire à partir d’une décision du médecin signataire de la procédure placé en position d’expert, avec laquelle il lui arrive d’être en désaccord !. Une différence avec la modalité précédente est que le médecin destiné à être thérapeute a la possibilité de prononcer une sortie immédiate : On sait que dans la pratique c’est très difficile, précisément parce qu’il n’a pas initié le processus.
Pour que s’installe une relation
thérapeutique, il faut que la confiance soit partagée, c’est-à-dire que le
médecin prodigue librement des soins à un patient qui suppose en tirer profit.
Le fait que les avis et moyens
proposés par des médecins différents puissent diverger n’est pas d’ailleurs à
considérer nécessairement comme une inanité mais comme une ouverture dans le
champ de la science et des libertés. Cela montre suffisamment que la médecine
ne relève pas des mêmes registres que l’exécutif ou le judiciaire.
On souhaiterait seulement alors que
celui-là même qui propose des soins diligents soit en état de les prodiguer tel
qu’il les conçoit. Mais la loi de 1990 ne lui en laisse pas le droit. Elle
dilue les responsabilités des médecins de telle sorte que plus personne n’est
responsable de rien de ce qui est fait dans ladite procédure qui pourtant est
exécutoire.
En fait ce qui importe actuellement
dans l’hospitalisation sous-contrainte c’est la contrainte par
l’hospitalisation et non l’hospitalisation par la contrainte car ce serait
dans ce cas le médecin thérapeute qui la déciderait !
En médecine générale, la contrainte peut permettre des actes thérapeutiques mécaniques comme une vaccination, un geste chirurgical, etc. On trouve d’ailleurs à ces actes des limites, non seulement dans l’Éthique, mais aussi dans leur efficacité proprement médicale précisément parce qu’ils négligent la dimension psychique de l’individu. C’est de la médecine « animale » encore que la dimension psychique ne soit pas absente chez les animaux et que l’homme soit un animal, mais on néglige cette dimension dite « psychique ». On ne traite pas les animaux comme des « sujets de Droit ». Ils n’ont pas ou plus de place dans les tribunaux en tant qu’auteurs responsables de leurs actes ! parfois on les élimine parce qu’on les accuse d’être malades. Cela ne veut pas dire les reconnaître comme « sujets ».
Ceci nous fait comprendre que plus
l’individu est considéré comme « sujet », plus sa dimension psychique
est reconnue et plus la demande du sujet est nécessaire pour les soins.
En médecine souvent, la question du
psychisme peut être considérée comme périphérique dans les soins. En
psychiatrie elle devient centrale. La question du secret médical se
calque d’ailleurs exactement sur la même aire de réflexion et c’est pourquoi le
secret médical est impérieusement nécessaire aux soins psychiatriques.
Le secret médical n’existe pas à
l’égard des animaux. Il ne protège pas la relation du vétérinaire à l’animal
qu’il soigne.
Les animaux peuvent figurer dans les tribunaux et peuvent apparaître parfois comme des dangers. Un juge peut ordonner des mesures à leur encontre. Cela ne veut pas dire les reconnaître comme sujet, ni les juger.
La « judiciarisation des
hospitalisations sous-contrainte » conduirait tristement à évoquer la
comparaison.
On ne peut demander à la Police
chargée de régler l’ordre public de porter des indications thérapeutiques, ni
aux juges de se préoccuper d’une argumentation psycho.* (cf. : S. Freud
écrit dans : « Quelques
notes additionnelles à l’interprétation du rêve dans son ensemble : « Le médecin laissera au juge
le soin d’établir, dans un but social, une responsabilité morale limitée
artificiellement au Moi métapsychologie. Tout le monde sait à combien de
difficultés il se heurte pour donner à ses conclusions des suites pratiques qui
n’aillent pas à l’encontre des sentiments humains».).
Il appartient aux médecins de diriger les
soins pour éviter qu’ils ne dirigent des sujets ni ne contrôlent l’ordre public
— ils n’auraient d’ailleurs aucun moyen pour le faire !
Quelques expériences peuvent nous éclairer :
1 Par le pouvoir
médical donné aux juges, l’ « injonction thérapeutique »
faite par les juges aux « toxicomanes » en application de la
loi du 31.XII.1970 ne semble pas avoir prouvé son efficacité 26 ans après
sa promulgation..
2 Par le pouvoir
donné aux Préfets, la loi du 30 juin 1838 n’a pas prouvé non plus son
efficacité thérapeutique 150 ans après sa promulgation puisque les malades
mentaux qui n’étaient qu’au nombre d’environ 3000 au début du XIXe siècle
dépassent aujourd’hui 800.000 en France !
3 A l’inverse, nous
avons été amenés à soigner des toxicomanes qui demandaient des soins ne
serait-ce que parce qu’ils étaient tracassés et poursuivis pour les
conséquences judiciaires punitives de leur toxicomanie et cela a permis des
guérisons.
4 Lorsque les juges
au lieu de juger la délinquance des toxicomanes les enjoignent de consulter un
médecin, les toxicomanes demandent au médecin des certificats qu’ils
considèrent comme des « laisser-passer » dans la voie de
l’interdit. En pratique, le fait « d’autoriser » les conséquences
délictueuses revient à renforcer la toxicomanie du fait que la maladie (si
cela en est une - peu importe ici) devient la condition de l’immunité
pénale.
Il n’est plus possible au médecin de soigner quiconque dans ces conditions.
En réalité, ce à quoi il faut que les juges
s’attachent, ce n’est pas à la toxicomanie en tant que phénomène biologique,
voire psychique si on veut parler ainsi, ayant ses métabolismes propres, car ce
n’est pas à eux qu’il revient de l’apprécier ,
mais à ses conséquences fautives s’il
y en a. ( en tant que faute dans ses rapports à autrui, eu égard aux
interdictions de culture, de consommation, de vente, etc.… si c’est le cas)
Cela
permet alors à une réelle demande de soins d’être formulée.
Par l’injonction thérapeutique de
substitution, le juge se prive de son rôle judiciaire, prive le
consultant de faire une demande de soins et le médecin de sa possibilité
de diriger les soins.
On comprendra encore la fonction
d’anticipation de la loi sur le déterminisme de la causalité psychique avec le cas
de l’ivresse : sachant que l’ivresse favorise certaines dés-inhibitions,
certaines personnes peuvent être tentées de boire pour agir. Mais sachant
qu’elles pourraient grâce à la reconnaissance d’un état démentiel passager agir
dans l’impunité, elles pourraient être ainsi incitées à la faute.
Un tel mécanisme n’a d’ailleurs pas
besoin d’être conscient pour être opérant. Certes chaque pathologie pose des
problèmes particuliers. Chaque patient pose des problèmes particuliers, mais
quelle que soit l’appellation de la pathologie, il est essentiel de préserver
la possibilité de la demande de soins qui peut être articulée par tout un
chacun, délirant ou non dès lors qu’il est en souffrance. Il appartient aussi
au médecin de se proposer. Tel qu’il apparaît au médecin, chaque cas est
complètement particulier.
Essayons cependant d’aborder
maintenant la systématisation des deux motifs légaux traditionnels justifiant
jadis « l’hospitalisation d’office », que sont « le danger
pour soi-même » ou « le danger pour autrui » telle
qu’elle apparaît au Préfet ou apparaîtrait à un juge. Dans le premier cas, le
patient est confronté à lui-même ; il peut présenter des symptômes
« morbides » comme par exemple des hallucinations diverses et
tout ce que le langage médical a déjà pu recenser en employant son vocabulaire
propre…, etc.
Si ceux-ci sont de tonalité
hédonique, agréables pour le patient il peut s’en satisfaire : s’il déclare
vivre heureux et qu’il ne nuit ainsi à personne, pour quel motif intervenir ?
De quel droit un Juge, un Préfet, le monde entier se permettraient-ils
d’intervenir auprès d’un être ainsi satisfait qui ne dérange personne et ne
transgresse aucune loi ? car la loi est là en effet pour fixer les Droits et de
Devoirs de chacun, délimitant ainsi ceux d’autrui (dont l’État) à son égard.
Toute la réflexion transcendantale qui peut s’ensuivre de notre exemple se
situe hors du cadre de réflexion d’une république laïque et démocratique comme
prétend l’être l’État de droit français.
A l’inverse si les symptômes sont de
type pénible, le patient pourra demander des soins. S’il n’en demande pas le
psychiatre pourra parler de masochisme, question psychiatrique fort
embarrassante en théorie mais nullement en pratique sitôt que l’on se pose la
question du droit des personnes à penser librement et qui nous ramène au cas
précédent.
L’article 63 de l’ancien Code
Pénal (sur l’assistance à personne en danger) qui en lui-même suffit
largement à justifier les soins que les médecins pensent devoir prodiguer aux
malades mentaux sans avoir recours à une loi d’exception trouve ici ses
limites.
Dans quel cas doit-on
« secourir » quelqu’un contre son gré ? L’expérience montre que cette
invocation du « secours » est à la base de bien des
« abus » de la psychiatrie. Or ce n’est ni un débat judiciaire ni un
débat Préfectoral. C’est un débat de conscience pure, de médecin (spécialiste
ou non) ou de simple citoyen ; quitte à chacun, bien sûr, d’en répondre (voir
notre article « Habeas Corpus et système psychiatrique français »
).
On ne pourra, en effet, jamais mettre un terme à toute discussion vaine sur cette notion du « Bien » « contre le gré » par la psychiatrie à moins de ne subduire le concept au point de l’impliquer dans toute forme d’opposition d’un sujet, voire de toute revendication de liberté d’exister à sa façon.
Une telle ambition ne peut séduire
qu’un système tyrannique ! Combien préférable ne serait-il pas de définir —
c’est-à-dire montrer que n’est pas infini — le domaine de la psychiatrie !
Combien préférable ne serait-il pas aussi de porter d’abord
Le deuxième cas de motivation de la contrainte Préfectorale secours à ceux qui, non seulement en ont besoin, mais aussi le demandent , concerne la situation d’un supposé malade mental dangereux envers autrui et ne pose pas non plus de problèmes insolubles. Si un « malade » exprime sa maladie par des actions surprenantes mais non interdites, c’est-à-dire autorisées, en actions ou en paroles, il n’y a aucun intérêt à l’hospitaliser de force. S’il y a un doute sur le caractère autorisé du comportement, rien n’empêche de le juger. Il s’agit de juger ici du comportement et non de la folie.
Si le « malade » commet
des actes répréhensibles et interdits, il faut les juger pleinement,
c’est-à-dire :
1. Établir la matérialité des faits
2. Juger
les actes avec défense des parties
3. Condamner, le cas échéant, ce qui est
loin d’être particulièrement le but de la justice.
4. Appliquer
la peine si le sujet est en état de la supporter, la peine devant être
choisie pour être appropriée.
Cette
peine peut être un travail d’intérêt public, une amende, une condamnation à
l’enfermement pour empêcher un individu de nuire, etc. Elle n’a pas de
prétention thérapeutique en soi et il n’est pas question de laisser un individu
nuire à autrui. Mais on ne peut, en aucun cas, appeler hospitalisation, vu le
sens actuel du mot hôpital, une contrainte judiciaire destinée à protéger la
société d’un malfaisant. Appeler hôpital un lieu d’enfermement dépendant
directement soit d’un Préfet soit d’un juge est une pure imposture.
Il
n’a jamais été par ailleurs empêché qu’un médecin soigne un prisonnier. Que les
prisons présentent des lieux d’accueil dignes de leurs fonctions est un
problème qui ne saurait être évacué par l’existence des hôpitaux par ailleurs.
En
fin de compte, si un malade mental délinquant doit être privé de liberté,
il sera certainement moins « confusogène » pour lui de l’être pour sa
« délinquance » que « pour sa maladie sans jugement ».
Il faut laisser au psychiatre la possibilité de poser des indications, de demander éventuellement au juge d’applications des peines une suspension de celle-ci pour des raisons médicales. Mais de même que l’on demande aux médecins de ne pas soustraire un patient à la justice, en se prétendant eux-mêmes juges, on demandera ici aux juges de ne pas se substituer au médecin.
Ces
confrontations qui laissent libre le champ de la « différenciation »
et aussi bien dans les accords que dans les désaccords ne peuvent que
bénéficier à chacun des deux domaines (médecine et justice).
On
aura bien sûr remarqué ce point fondamental que la doctrine Préfectorale de la
notion de danger pour soi-même ou autrui est indépendante de la notion d’urgence
(souvent pourtant invoquée) et aussi de la notion d’acte pénalement
répréhensible. La « judiciarisation des hospitalisations sous
contraintes » ne prendrait pas davantage en compte cette dernière
préoccupation ; mais on peut craindre une assimilation de la maladie à la
faute.
Si
le système de la « judiciarisation de l’hospitalisation sous
contrainte » était retenu, il n’aboutirait probablement qu’à cette sorte
de longue garde à vue médicale inutile et sans but comme c’est
actuellement souvent le cas, dans laquelle la camisole chimique remplace les
murs de l’exclusion. Mais qu’adviendrait-il si le médecin refusait de prescrire
ce qu’il estime être nuisible à un patient ? : le juge serait-il amené
à prescrire un traitement précis (comme une castration en cas
d’hyperactivité[1]
sexuelle par exemple ? [ cela
n‘est pas du tout anachronique et figurait encore dans une encyclopédie
médicale des années 1950 : « …il serait inhumain de refuser la
castration chirugicale à…. » sans demander à l’intéréssé son avis,
naturellement ! ] )
N’est-ce pas plutôt au médecin de répondre des indications qu’il recommande ?
Parmi les exemples possibles de subordination de la médecine à la justice,
pourrait-on considérer comme un geste médical thérapeutique le fait pour un
médecin de pratiquer une amputation de main d’un voleur à la demande d’un
tribunal ? Il ne viendrait à personne l’idée de parler ici de thérapie sinon de
sanction judiciaire. Et il n’est pas au médecin d’en discuter la légitimité en
tant que médecin, mais de savoir s’il accepte d’être l’exécutant d’un ordre
judiciaire qui peut être en accord ou en désaccord avec sa conscience et sa
déontologie professionnelle qui l’instaure dans ses fonctions.
Dans
l’état actuel de notre déontologie, on demande au médecin d’être le garant
de la thérapie et au juge de la légitimité.
Si en dehors de toute considération « d’ordre public », dont il n’est pas le responsable, le médecin estime qu’un état pathologique ou la conduite d’un traitement nécessite une hospitalisation, il lui appartient d’en assumer l’indication.
Qu’il
s’agisse d’hospitalisation, de médication, de psychothérapie, c’est
l’utilisation qui en est faite qui la justifie et c’est au thérapeute de le
faire.
Le
médecin n’a pas à soigner différemment ce qui, suivant les droits, dans leurs
diversités que l’on pourrait découvrir, un jour est délinquance ou un autre
jour non-délinquance, pour ne pas dire obligation .La notion de
« maladie » n’a pas grand choses à voir avec cela !
Ainsi un médecin qui ne se sent pas disposé à soigner correctement
une personne pour quelque raison que ce soit, doit se récuser en tant
que médecin, thérapeute ou expert, et ce cas est prévu par la déontologie
médicale.
A l’inverse, on concevrait mal qu’un
juge, lui, partage ces dispositions. On conçoit finalement qu’une sanction
judiciaire de la maladie serait ressentie par le patient comme particulièrement
confusogène.
En conclusion, la « judiciarisation de l’hospitalisation sous contrainte » d’un sujet « supposé être malade mental » qu’il soit ou non auteur d’une faute répréhensible n’améliorerait en rien la triste législation actuelle.
Elle
en masquerait peut être un peu plus les termes en « habillant en Droit »
ce qui n’est qu’une pure « intervention de puissance ».
Elle
maintiendrait cette sorte de « déni de justice légalisé »
comme un privilège de seigneurie féodale dont la psychiatrie en France garde
l’une des dernières exclusivités.
L’échec
des traitements médicaux resterait pratiquement assuré et les malheureux
hospitalisés dépouillés de leur dignité de citoyen. Quant aux qualités
policières, même préventives d’une telle entreprise, elles ne peuvent être que
fort médiocres. C’est pourquoi nous demandons simplement que ces personnes
aient droit aux juridictions ordinaires.
On reste étonné qu’une France dite des droits de l’Homme assume un si extraordinaire paradoxe dans le domaine des libertés publiques.